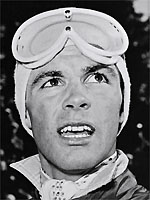|
La compétition
L'épreuve-reine. Elle fait partie des deux épreuves d'origine du ski alpin. C'est une course de vitesse disputée à des vitesses proches de 130 km/heure. A l'origine, il s'agissait de rejoindre l'arrivée par la trajectoire choisie par le concurrent. Les skieurs s'élancent un par un, toutes les 90 secondes. A l'arrivée, ils sont départagés au 100e de seconde. Aux JO et aux Mondiaux, le temps de la descente ne doit pas être inférieur à 2 minutes
Il dérive du slalom géant et combine en une seule manche, la vitesse de la descente et le tracé du slalom géant. A sa création en 1981, les descendeurs ont été plus avantagés.
Disputé en une seule manche de 1950 (date de sa création) à 1975, il se court désormais en 2 manches. Le concurrent ayant réalisé le meilleur temps total est déclaré vainqueur. L'ordre de départ de la 2e manche est déterminé par les résultats de la 1re. Les 15 meilleurs temps partent dans le premier groupe, l'auteur du meilleur temps partant le dernier de ces 15 coureurs.
La discipline technique par excellence. Le principe est le même que pour le géant. La disposition des portes doit obliger le skieur à effectuer le plus possible de virages différents. En outre, le tracé d'un slalom doit être fluide. La largeur d'une porte de slalom, délimitée par des piquets flexibles, varie entre 4 et 5 m. Comme pour le géant, le nombre de portes est déterminé par la dénivellation : entre 55 et 75 pour les messieurs, 45 et 60 pour les dames. Le dénivelé doit être de 140 à 200 m (messieurs) ou de 120 à 180 m (dames). Des expériences de slaloms parallèles ont été tentées. Sans grand succès.
Il associe les résultats d'une descente et d'un slalom. L'addition des temps des deux épreuves permet de désigner le gagnant. Le skieur qui totalise le plus petit temps à l'issue des 2 épreuves est proclamé vainqueur. Lors de l'introduction du ski alpin aux JO, seul le combiné donnait lieu à des médailles, puis il a disparu du programme entre 1952 à 1984 au profit du slalom géant. A partir de 1982, le combiné, organisé aux JO et aux Mondiaux, est disputé au cours de 2 épreuves organisées à part. Seul le résultat final donne lieu à des médailles.
Descente
Dénivellation : entre 800 et 1100 m (messieurs) ou 500 et 800 m (dames). Le nombre de portes doit être important dans les secteurs pentus.
Dénivellation : 300 m au minimum. Les portes, au nombre de 35 pour les messieurs et de 30 pour les dames, sont distantes de 4 à 8 m.
Dénivellation : 300 m au minimum. Les portes, au nombre d'une cinquantaine, dépendent du dénivelé (au minimum 300 m) et de la longueur de la course. Une porte, matérialisée par deux piquets reliés par une banderole de 1 m sur 70 cm, doit avoir une largeur de 4 à 8 m.
Dénivellation : 150 à 220 m (messieurs) ou de 130 à 200 m (dames). Le nombre de portes est déterminé par le dénivelé : entre 55 et 75 (messieurs) ou 45 et 60 (dames). La largeur d'une porte de slalom, marquée par des piquets flexibles, varie entre 4 et 5 m.
Une paire de skis dont la taille a été sensiblement raccourcie depuis quelques années
Un casque en matière plastique. Intégral et très robuste pour la descente, le super-G et le géant, il est plus léger pour le slalom. Pour cette épreuve, il est équipé d'une mentonnière rigide destinée à protéger le visage des chocs avec les piquets.
Une combinaison ajustée au corps en matière très légère. Pour la descente et le super-G, la partie recouvrant la colonne vertébrale est rembourrée. Pour le slalom, des renforts sont placés sur les bras, les tibias et les genoux.
Des chaussures en matière plastique renforcées. Celles-ci sont surélevées afin d'éviter le contact avec la neige
Une paire de bâtons courbés pour coller plus au corps et favoriser l'aérodynamisme pour la descente, le super-G et le géant. Pour le slalom, les bâtons sont droits et équipés d'une poignée renforcée sur l'avant.
L'origine du ski comme moyen de transport remonte à plusieurs milliers d'années avant JC. Un dessin gravé représentant un renne et un chasseur muni de skis a été mis au jour en 1934 par un archéologue russe, près du lac Onega. Un dessin dont la date est estimée à une période entre 6000 et 12.000 avant notre ère. D'autres documents datant de 360 av. JC montrent des skis dissymétriques (un ski gauche, long et étroit pour permettre une meilleur glisse, et un ski droit, large et court). Plus près de nous, le futur roi de Suède, Gustav Vasa, fuit à skis de Mora à Saelen, en 1520. C'est en 1835 à Morgedal (sud de la Norvège) qu'est lancé le ski de compétition, à l'initiative de Sondre Nordheim. C'est encore lui qui invente la première fixation. En 1888, le Norvégien Fidtjof Nansen marque les esprits en traversant à skis le Groenland. Pourtant, l'emploi du ski est souvent difficile sur les pentes des montagnes européennes. Aussi, en 1879, un Grenoblois, Henri Duhamel, essaie-t-il des skis adaptés aux fortes déclivités. Puis un Autrichien, Mathias Zdarsky met au point des skis courts (1,80 m au lieu de 3 m), sans rainure, ainsi qu'un bâton sans rondelle pour freiner et négocier les virages. Quant aux Suisses, ils reconnaissent en Christophe Iselin le "père du ski", après son exploit de 1893 : il est le premier à franchir un col suisse, le Pragel. Aussi curieux que cela puisse paraître, le précurseur du ski alpin moderne est un Anglais, sir Arnold Lunn (1882-1974)... même si dans le même temps, l'Autrichien Hannes Schneider invente la technique de l'Arlberg et forme les premiers moniteurs de ski. Installé en Suisse à Muerren, sir Arnold Lunn organise et codifie les compétitions de descente et de slalom, dont le nom signifie "course en S" en norvégien. Fondateur du Kandahar Ski Club en 1924, année de création de la Fédération Internationale de Ski, qui défend alors les disciplines nordiques, le Britannique lance le premier combiné descente-slalom, quatre ans avant de s'associer avec Hannes Schneider pour créer la première épreuve classique, l'Arlberg-Kandahar. Organisés sous le nom de "Courses internationales de la Fédération Internationale de Ski", les premiers Championnats du monde voient le jour en 1931 à Muerren. L'année précédente, la FIS avait adopté les règlements de la descente et du slalom. Le Suisse Walter Prager gagne la descente masculine, la Britannique Esme Mackinnon s'impose dans l'épreuve féminine. Il faut attendre cinq ans et la 4e édition des JO d'hiver à Garmisch-Partenkirchen pour voir l'inscription du ski alpin au programme olympique. Quatre courses (une descente et un slalom pour les messieurs et pour les dames) sont disputées, mais seules seront décernées les médailles du combiné. L'Allemand Franz Pfnuer 2e de la descente et 1er du slalom, s'adjuge la médaille d'or. Le Norvégien Birger Ruud, par ailleurs médaillé d'or du saut à skis, avait été le vainqueur de la descente. Chez les dames, doublé des Allemandes Christl Cranz et Kaethe Grasegger. Ce n'est qu'après-guerre et les JO de 1948 que la descente et le slalom sont considérés comme disciplines olympiques. Après la descente et le slalom, le slalom géant apparaît aux Mondiaux de 1950 organisés pour la première fois hors d'Europe, à Aspen au Colorado (Etats-Unis). Pour cette épreuve, les portes, au nombre de 35 (messieurs) et de 30 (dames), sont distantes de 10 mètres. Le super-G, qui combine la vitesse de la descente et la technique du slalom géant, voit le jour en 1981 et est introduit en Coupe du monde deux ans plus tard. Il apparaît au programme olympique à Calgary en 1988. 1936 Combiné messieurs et dames (absent de 1952 à 1984) Descente M + D, Slalom M + D Slalom géant M + D Super-G M + D
|